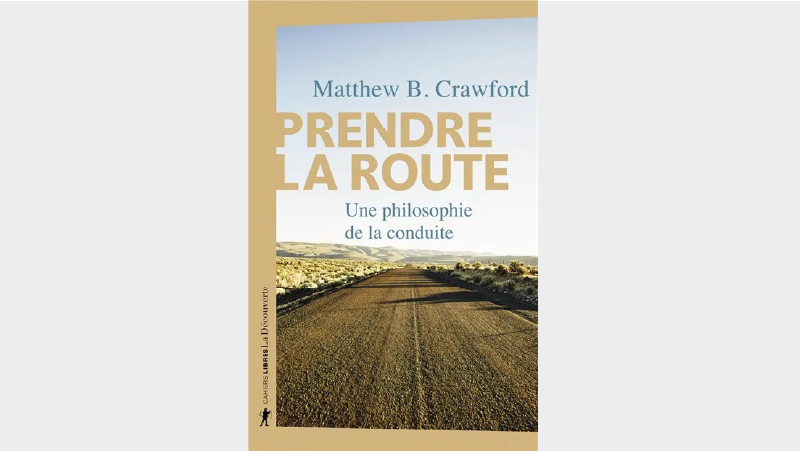Auteur : Matthew Crawford – Date de Publication : 2020 – Éditeur : Harper (version en Anglais « Why we drive ») et La découverte
Prendre la route : Une philosophie de la conduite
Au volant, nous n’avons pas conscience des liens entre technologie, autonomie et liberté et sur notre rapport aux machines et aux choix vis à vis de la technologie et des conséquences sur notre quotidien.
Sortie de route
En prélude du livre, l’auteur décrit une de ses expériences de conduite hors route lors d’une randonnée à moto tout terrain dans une zone boisée. La conduite sur un sentier étroit et sinueux, avec des obstacles tels que des racines et des branches tombées nécessite une telle intensité de la concentration. Réussir à surmonter ces défis lui fait ressentir une vraie satisfaction existentielle. Il compare cette expérience à la marche dans des environnements urbains hostiles. Crawford se sert de cette expérience pour illustrer l’idée que le risque et l’exposition à l’incertitude sont intrinsèquement liés aux possibilités de se sentir humain de vivre pleinement son existence. Il critique la vision contemporaine de l’automatisation et de l’élimination des contingences de la vie, mettant en avant le fait que cela réduit les moments de sérendipité qui humanisent notre expérience de la mobilité.
Conduite et humanisme
Crawford explore ensuite l’impact de l’automatisation et des voitures autonomes sur la conduite et la société. Il critique la vision de l’avenir avec des voitures autonomes, soutenue par ceux qui promettent une conduite plus reposante et productive. L’automatisation partielle et des fonctionnalités comme le contrôle de vitesse et la navigation GPS aurait au contraire rendu la conduite ennuyeuse et passive et augmenté les distractions et les accidents. Il compare la conduite à un voyage en avion, où les passagers sont déconnectés de leur environnement et de leur propre compétence.
Une future domination des voitures autonomes pourrait rendre la conduite humaine obsolète voire illégale et transformerait les conducteurs en simples passagers, gérés par des systèmes technocratiques. Tandis que la conduite, « la vraie », c’est à dire celle sans GPS ni automatisation enrichit l’expérience humaine et permet d’entretenir les valeurs humanistes de compétence, de liberté et de responsabilité.
L’impact des voitures sur l’urbanisme : voiture individuelle versus bien commun
Crawford explore aussi comment l’urbanisme moderne et la planification centralisée ont transformé les villes américaines, souvent et malheureusement au détriment de la vie sociale urbaine. La dépendance excessive à l’automobile a mené à la congestion, la pollution et la dégradation des espaces publics. En outre, les politiques de transport ont souvent favorisé les voitures au détriment des transports en commun, exacerbant les inégalités sociales et économiques. Certes les voitures sont perçues comme des symboles de liberté et de statut social mais avec des conséquences catastrophiques. Crawford appelle donc à une réévaluation de la place des voitures dans la société et à la promotion de solutions de transport plus durables et équitables, en mettant l’accent sur la préservation des espaces publics et les interactions sociales.
Restauration et personnalisation des voitures anciennes : une forme de résistance
Crawford met en avant l’importance de l’artisanat et de la compétence technique dans la restauration de véhicules. Ce processus permet aux individus de se reconnecter avec des compétences manuelles et de trouver une satisfaction personnelle dans la création et la réparation. Crawford décrit comment les « gearheads », ces passionnés de mécanique-auto et amateurs de voitures anciennes, s’adonnent à la restauration de véhicules anciens et transforment de véritables épaves en machines fonctionnelles et esthétiques. Ces activités sont semées d’embûches, de défis et de frustrations. C’est le cas, par exemple, de la recherche de pièces rares. Celles-ci n’etant plus fabriquées, les obtenir nécessite de surmonter des problèmes techniques complexes et de comprendre en profondeur le fonctionnement des vieux systèmes de classement des pièces détachées.
Pourquoi s’atteler à de tels défis ? En réalité, selon Crawford, cette culture de la restauration automobile représente une forme de résistance à la consommation de masse et à l’obsolescence programmée. Cette activité sert à défendre des valeurs telles qu’autonomie, compétence et créativité dans un monde de plus en plus dominé par la technologie et la standardisation.
La dimension ludique de la conduite et des sports mécaniques
Crawford explore aussi la dimension ludique et compétitive des sports mécaniques. Il examine comment les sports motorisés, tels que la course automobile ou de motocyclettes, incarnent l’esprit de jeu et de compétition. Il souligne l’importance de la maîtrise technique, du courage et de la capacité à prendre des risques, ainsi que la satisfaction personnelle tirée de l’amélioration de ses compétences que cette pratique génère. Le chapitre aborde également la camaraderie et la solidarité parmi les participants avec la création de communautés de passionnés. En conclusion, Crawford célèbre les sports mécaniques comme une expression de la liberté individuelle et de l’excellence humaine, plaidant pour la reconnaissance de leur valeur en cultivant des compétences et des vertus essentielles.
L’autonomie individuelle en danger ?
Selon Crawford, les systèmes de surveillance et de régulation tels que radars automatiques, caméras de circulation, influencent non seulement comportements mais aussi la manière dont nous percevons l’autorité. Ces systèmes mettent en danger nos capacités individuelles à exercer nos propres jugements et à prendre des décisions responsables.
La prolifération des règles et des dispositifs de surveillance, parce qu’ils remplacent la prise de décision individuelle par un contrôle centralisé, pourrait éroder la confiance et la coopération entre les citoyens. Or la confiance entre les citoyens ainsi que la capacité à improviser et à s’adapter aux situations changeantes ne sont-elles pas des éléments clefs pour maintenir une société fonctionnelle ?
Dès lors, Crawford demande comment articuler liberté individuelle et sécurité publique ? A l’extrême, la quête de sécurité absolue dans un monde de plus en plus surveillé et réglementé et de plus en plus dominé par la technologie peut conduire à une perte de liberté et d’autonomie. L’auteur plaide plutôt pour un équilibre entre la régulation nécessaire et la préservation de l’autonomie individuelle, en insistant sur le fait que la véritable liberté implique la responsabilité et la compétence personnelle.
Surveillance numérique et gestion algorithmique : enjeux de souveraineté et d’autonomie dans les villes modernes
Crawford poursuit son enquête en abordant la question de l’impact des technologies de surveillance et de gestion algorithmique sur nos vies quotidiennes, en particulier dans le contexte urbain. Des entreprises comme Google utilisent des technologies avancées pour collecter des données et influencer nos comportements, souvent sans notre consentement explicite. Cela est de notoriété publique. En résulte une perte de souveraineté individuelle et collective.
Crawford illustre cette dérive avec plusieurs exemples : Google Street View en raison de son caractère intrusif et que Crawford rattache à une tradition de cartographie utilisée comme outil de contrôle ainsi que l’exemple de l’ubérisation des professions traditionnelles comme les chauffeurs de taxi et le concept de « smart cities » où les infrastructures urbaines sont gérées par des systèmes automatisés.
Crawford appelle à une réflexion critique sur la manière dont nous voulons que nos sociétés soient gérées, en soulignant l’importance de préserver l’autonomie individuelle et la compétence personnelle face à l’ascension des technologies de surveillance et de gestion algorithmique.
Cognition prédictive et cognition incarnée
Crawford s’appuie sur les travaux de Sandy Clark, chercheur en sciences cognitives, pour explorer comment les êtres humains perçoivent et interagissent avec le monde. En particulier dans le contexte de la conduite et comment les capacités cognitives humaines de prédiction et d’ajustement mutuel sont essentielles pour une conduite efficace et sécurisée et comment ces capacités peuvent être entravées par une dépendance excessive à la technologie et à la régulation algorithmique. Sandy Clark est mondialement connu pour ses travaux sur la cognition prédictive et la cognition incarnée (enactive cognition).
D’après ces recherches, le cerveau humain anticipe constamment le monde en utilisant les signaux sensoriels pour affiner ses prédictions. La perception et l’action sont étroitement liées, et nous ajustons nos prédictions en fonction des données sensorielles. C’est cela qui fait que conducteurs parviennent à anticiper les actions des autres usagers de la route et à ajuster leur comportement avec une conduite fluide et sécurisée. De plus, les normes sociales et les comportements partagés rendent les actions des autres plus prévisibles, facilitant la coordination sur la route.
Ainsi, notre interaction avec le monde physique influence directement la cognition humaine, et la conduite engage pleinement notre corps et notre esprit. L’engagement actif avec notre environnement est crucial pour maintenir des compétences cognitives et motrices et l’automatisation excessive peut nuire à cette interaction et affaiblissant ces compétences.
Des rats conducteurs
D’ailleurs cette cognition incarnée n’est pas exclusivement réservée aux humains. Crawford fait aussi appel à une expérience menée par les scientifiques en neuroscience L. Elizabeth Crawford et Kelly Lambert, où des rats ont appris à conduire des véhicules miniatures dans des environnements enrichis.
Dans cette expérience menée par ces chercheurs, des rats ont été formés pour conduire à travers un processus conçu pour leur permettre d’apprendre progressivement à manipuler les commandes d’une petite voiture conçue spécifiquement pour eux. Les résultats de cette expérience montrent que les rats qui apprennent à conduire montrent des niveaux de stress réduits par rapport à ceux qui ne conduisent pas, suggérant que l’engagement actif dans une tâche complexe peut avoir des effets bénéfiques sur le bien-être.
Des résonances avec Illich Simondon et Jarridge
On pourrait regretter que le livre ne traite pas des conséquences écologiques telles que le poids écologique des automatisations, leur viabilité en raison de la finitude des matériaux, etc… Certes. Mais ces questions ne sont pas vraiment le propos du livre qui s’intéresse avant tout à questionner notre rapport à la technologie en prenant la conduite comme prétexte à ce questionnement.
Les idées de Matthew Crawford dans « Why We Drive » valorisent une technologie qui renforce l’autonomie, la liberté et l’individuation. La conduite automobile, pratiquée de manière consciente et responsable, devient un symbole de cette vision, permettant à l’individu de résister à la déshumanisation et à l’aliénation. Crawford nous invite à reconsidérer notre relation avec la technologie et à valoriser les pratiques qui renforcent notre autonomie et notre liberté.
Ces idées résonnent avec les pensées de Simondon, Illich. Les livre ne les évoque pas explictement. Ces penseurs ont pourtant examiné les implications sociales et philosophiques de la technologie. Cependant, notons que ces auteurs auraient probablement nuancé cette vision en soulignant que l’autonomie individuelle doit être mise en balance avec les « conditions associées » et le bien-être collectif, comme le défendait Simondon à partir des années 70. Pour Illich, cette quête d’autonomie pourrait plutôt s’exprimer à travers des pratiques comme la marche à pied, qui limiterait la « griserie » de la liberté en freinant l’excès de dépendance technologique.
Chez Praxilience, en tant qu’agence de redirection écologique, nous nous engageons à promouvoir des modes de vie qui valorisent le développement des compétences. Nous croyons que ces principes peuvent non seulement améliorer notre bien-être individuel, mais aussi contribuer aux redirections écologiques.
Nous vous recommandons vivement « Why We Drive » de Matthew B. Crawford meme à ceux qui n’ont pas encore appris à conduire…mais pas aux rats car ils n’ont pas encore appris à lire :).
Crawford, Matthew B., Marc Saint-Upéry, et Christophe Jaquet. Prendre la route: une philosophie de la conduite. Cahiers libres. Paris: la Découverte, 2021.